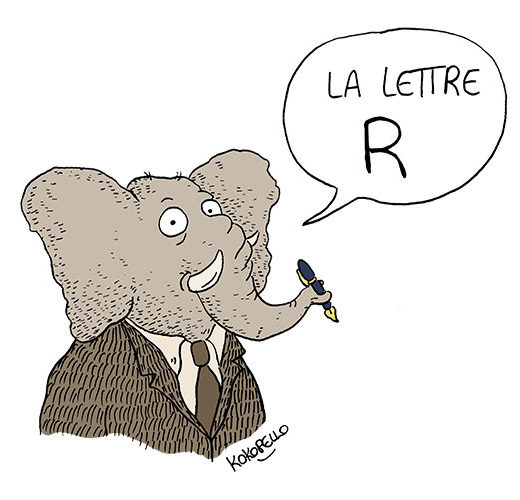L’écriture c’est la vie.
Chers lecteurs,
Je vous propose un entretien-portrait inédit, à plus d’un titre, avec une nouvelle personnalité qui vient à notre rencontre. Je vous laisse découvrir son parcours atypique mais logique qui vous permettra de connaitre mieux notre nouvel invité.
ENA. Ce sont sur les bancs de l’école nationale que notre interrogé peaufinera son cursus dans l’enseignement supérieur et permettra son intégration professionnelle à travers ses stages de fin d’études.
Outre-mer. Pièce maîtresse dans son parcours, son début de carrière au près du Ministère de la rue Oudinot lui ouvrira les portes des connaissances et du savoir professionnel.
Bureau des élections. C’est dans le cœur du réacteur nucléaire du Ministère de l’Intérieur que notre interrogé déploie ses ailes avec la campagne présidentielle de 2012 en point d’orgue.
#DirectAn. Autour du président Claude Bartolone, notre personnalité va étoffer ses compétences pour les affaires constitutionnelles, intérieures et outre-mer.
Matignon. Notre interrogé y effectuera un passage auprès de 2 Premiers ministres, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, en apportant son expertise de l’Outre-mer.
DILCRAH. C’est au sein de cet Organisme Interministériel que le parcours professionnel de notre personnalité s’envole avec l’arrivée de sa nomination préfectorale.
RATP. Nouveau défi avec une expérience professionnelle où notre interrogé s’impliquera autour des questions de laïcité et la découverte du monde de l’entreprise.
Nouvelle-Calédonie. Dans la continuité professionnelle, une mission de médiation confiée par le président de la République emmènera notre invité sur cette île de l’Océanie.
Régions de France, Nouvelle expérience. Nouveau défi. Notre invité arrive au sein de cette association en soutien à Carole Delga et Renaud Muselier en devenant délégué général.
Je vous laisse découvrir le portrait de M. Frédéric Potier, Délégué général des Régions de France.

Ce portrait a été réalisé lors d’un entretien aux Régions de France le 28 mars 2025.
Bonne lecture !
@romainbgb – 03/04/25
***
Biographie Express de M. Frédéric Potier :
*1980 : naissance à Pau (Pyrénées-Atlantiques).
*1998-2003 : Master en Affaires Publiques à Sciences Po Bordeaux.
*2004-2006 : École Nationale d’Administration (promotion Simone Veil).
*2006-2008 : Chef du bureau des affaires politiques et des libertés publiques au Ministère des Outre-mer.
*2008-2009 : Directeur de cabinet de M. Fragneau, préfet de la région Centre-Val de Loire et du Loiret.
*2009-2012 : Chef du bureau des élections au Ministère de l’Intérieur.
*2012-2014 : conseiller pour les affaires constitutionnelles, l’intérieur et l’outre-mer du président de l’Assemblée nationale.
*2014-2017 : conseiller technique Outre-mer du Premier ministre.
*2017-2021 : nommé préfet en mission de service public et Délégué Interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’anti-LGBT à la DILCRAH.
*mai 2019 : titularisé en tant que préfet.
*2021-2024 : Délégué général à l’éthique et à la conformité à la RATP.
*2021 : publication de Pierre Mendès-France, la foi démocratique – aux éditions Bouquins.
*2022 : publication de La menace 732, aux Éditions de l’aube.
*2023 : publication de La poésie du marchand d’armes, aux Éditions de l’aube.
*2024 : publication de Jaurès en duel, aux éditions Le Bord de l’eau – Fondation Jean Jaurès.
*2024-2025 : Délégué général à l’éthique, la conformité, l’audit, au risque et contrôle interne à la RATP.
*mai 2024 : membre de la mission de médiation et de travail sur la Nouvelle-Calédonie, mandaté par le président de la République.
*depuis fév.2025 : Délégué général de Régions de France.
*mars 2025 : postface, Lettre à l’éléphant de Romain Gary, aux Éditions de l’Éclaireur.
***
À quoi rêvait le petit Frédéric lorsqu’il était enfant ?
« [Rires] Je crois que le petit Frédéric, lorsqu’il était enfant, aimait beaucoup lire. Il aimait déjà beaucoup écrire. Lorsqu’il était enfant, jusqu’à jeune adolescent, il rêvait de devenir journaliste. Les hasards de la vie ont fait qu’il a fait autre chose. [Rires] Je garde une grande passion pour l’écriture, le monde de l’édition, la Presse, les médias.
« Lorsque j’étais jeune adolescent, entre 9 et 13 ans, j’ai vécu en Norvège. Mon père travaillait pour Elf Aquitaine. Comme beaucoup de jeunes Français qui ont vécus à l’Étranger, je crois que cela a dégagé une certaine forme de curiosité pour mon pays. Mon père ramenait l’Évènement du jeudi, Le Canard enchainé. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qu’il y avait à l’intérieur mais je trouvais cela assez fascinant. J’ai l’impression que pour tous ceux qui ont vécu à l’Étranger, la France est encore plus belle, lorsque l’on la regarde de l’extérieur et qu’elle vous manque.
« Je ne parle pas du tout le norvégien. La Norvège est un pays magnifique. J’y suis retourné, avec mes enfants, il y a quelques années. J’adore tous les pays Scandinaves. C’est à la fois un modèle social-démocrate, qui moi m’a toujours fasciné, et puis une simplicité de vie avec le goût de la nature, du sport, qui m’a toujours intéressé. »
Comment est née votre rencontre avec la politique ?
« J’ai difficilement un seul souvenir à mettre comme cela sur la table, en thème de vie politique. Pour continuer sur la Norvège, mon père avait ramené le premier tome des Verbatim de Jacques Attali. Je me souviens d’avoir lu la trilogie lorsque j’avais 12-13 ans. J’étais assez fasciné de ce que je lisais autour du pouvoir et le récit autour du pouvoir mécano-décisionnel.
« Mon tout premier souvenir politique, lié à cela, pourrait être le référendum sur le Traité de Maastricht en 1992. Lorsque l’on vit à l’Étranger, on voit cette idée de construire l’Europe avec une fibre européenne assez spontanée. Le fameux débat entre François Mitterrand et Philippe Seguin, qui a marqué les esprits. J’ai les souvenirs des images d’un Mitterrand, déjà, très affaibli et de sa vivacité intellectuelle. J’imagine que lorsque j’ai vu cela, à l’époque, je ne comprenais pas tout. La petite phrase : « On ne va pas faire un plébiscite à l’envers ! », je trouvais cela assez puissant.
« […] D’autre part, est-ce que c’est vraiment mon rôle que de faire un plébiscite à l’envers ? Je me refuse à faire un plébiscite positif mais cela deviendrait un plébiscite négatif. […] »
François Mitterrand à Jean d’Ormesson – le 3 septembre 1992.
Que retenez-vous de vos années sur les bancs de l’ENA ?
« La scolarité à l’ENA a été beaucoup critiqué, à juste raison, puisque les enseignements y sont assez médiocres. Par contre, ce sont les stages qui y sont passionnants. J’ai eu la chance d’y faire 2 stages.
« L’un à la Préfecture de la Région Normandie pendant le 60ème Anniversaire du Débarquement, en 2004. C’était extraordinaire de voir passer des Anciens combattants, des Chefs d’États et tout le protocole attenant. C’était un évènement très lourd, qui mettait en branle tout l’appareil d’État.
« Mon 2ème stage je l’ai effectué en Algérie, à l’Ambassade de France, en 2004-2005. Rien à voir. [Rires] À une époque où le pays s’ouvre un peu mais où il y a encore des attentats. On était largement enfermé dans l’Ambassade.
« Ce qui reste anecdotique, c’est que les services de l’État ont une grande mémoire des stagiaires de l’ENA qui sont passé là. C’était assez marrant parce que les services de l’État ne cessaient de comparer les stagiaires de l’ENA, les uns aux autres.
« 2 ans avant moi, un jeune élève de l’ENA, qui était très brillant au dire de tout le monde, m’a précédé. Il s’appelait Boris Vallaud. Dans les autres stagiaires célèbres de l’Ambassade de France à Alger, il y avait un certain François Hollande. Régulièrement, on me parlait d’eux.
« Je garde de très bons souvenirs des stages effectués à l’ENA. J’y garde beaucoup d’amis proches. En ce qui concerne les enseignements, en eux-mêmes … pas grand-chose. J’ai beaucoup plus appris à Sciences Po Bordeaux qu’à l’ENA. »
Quelle expérience gardez-vous de votre passage au Ministère des Outre-mer ?
« Tout d’abord, le choix du Ministère des Outre-mer à la sortie de l’ENA, c’était un choix qui était socialement non-conformiste. J’aurai pu faire des choix beaucoup plus prestigieux aux yeux de mes collègues et des gens qui recrutaient à la sortie de l’ENA. J’aurai pu aller au Trésor, au Budget…
« J’étais 40ème / 100. Je n’étais pas trop mal classé, mais pas dans « la botte », comme on dit. Je n’avais pas envie de m’ennuyer. Je n’avais pas envie de passer ma vie à faire des tableurs Excel. J’avais envie de découvrir des univers différents. Pour cela, ce choix-là était assez fascinant.
« Il y avait un jeune ministre, qui s’appelait François Baroin. Il y avait des Directeurs qui étaient très dynamiques. Puis, surtout, l’avantage d’être dans un petit Ministère, c’est que vous êtes en première ligne !
« J’avais presque 26 ans, lorsque je suis allé préparer une révision constitutionnelle. J’allais aux bancs, au Parlement, derrière le ministre, lui glisser des petits papiers, des petites notes. J’allais en visite à Mayotte, à Saint-Martin, pour préparer des élections statutaires. Au fond, ces missions, ces responsabilités, ont vous les donne assez spontanément dans une petite structure ministérielle. Là où dans un gros Ministère, cela serait réservé à un Directeur, un Directeur général ou un SG.
« Cela a été, pour moi, très formateur. J’ai appris à faire des textes de lois. J’ai appris à écrire des décrets. J’ai appris à rédiger des notes pour des ministres, à accompagner des personnalités politiques. Cette période-là m’a été très utile ! »
Comment avez-vous vécu votre expérience à la Préfecture du Centre-Val de Loire et du Loiret ?
« Après l’Outre-mer, qui était une expérience professionnelle très atypique, mon Directeur de l’époque m’avait dit : « Il faut que vous fassiez quelque chose de très basique, de très logique. Rentrez un peu plus dans le moule ! » [Rires] C’est pour cela, directeur de cabinet à Orléans ! Non pas, qu’il n’y ait pas des singularités ! C’était des fonctions plus typiques de ce que l’on attend d’un sous-préfet.
« Là encore, cela a été très formateur parce qu’un directeur de cabinet d’un préfet de Région, il s’occupe à peu près de tout ! C’est-à-dire les visites ministérielles, les communications, les inondations, les cultes. Beaucoup de sécurité aussi, vis-à-vis de la délinquance. C’est très formateur parce que l’on est tout le temps sur la brèche. Parce que l’on est au contact d’un préfet de Région, qui lui a une très grosse expérience.
« J’ai beaucoup appris. J’ai découvert une Région que je ne connaissais pas. Avec un président de Région, François Bonneau, que j’ai retrouvé lors de mon arrivée aux Régions de France. Ce qui était rigolo ! »
Comment avez-vous vécu votre expérience au bureau des élections du Ministère de l’Intérieur ?
« C’était une très belle expérience que celle de travailler au bureau des élections, notamment lorsque vous préparez une élection présidentielle. C’était celle de 2012. C’est vraiment le cœur du réacteur nucléaire. C’est vraiment l’endroit où l’on ne peut pas se planter. Avant une présidentielle, tous les services de l’État s’arrêtent. On attend l’alternance, savoir dans quelle direction l’on va. Il y a une unité qui ne s’arrête absolument pas, qui a tous les yeux braqués sur elle : c’est le bureau des élections.
« Il faut beaucoup de solidité. Il faut beaucoup de sang-froid. Ce n’est pas forcément l’élection la plus compliquée à organiser parce que tout d’abord il y a une liste très fermée de candidats. Il y a le Conseil constitutionnel qui veille au grain. Il y a une commission de contrôle. Il y a un calendrier qui est très défini, simplement, on n’a pas le droit à l’erreur. Autant, la réforme de la carte-grise ou du permis de conduire, vous pouvez la reporter de quelques mois. Autant, une élection présidentielle, vous ne pouvez pas.
« C’est un poste de confiance. C’était un vrai honneur que l’on me confie ce poste-là, à moins de 30 ans. À l’époque, c’est Christophe Mirmand, aujourd’hui directeur du cabinet de Manuel Valls, qui a été préfet des Alpes-Maritimes, qui me confie cela parce que j’avais déjà fait cela au Ministère des Outre-mer. En 2007, j’avais déjà organisé sur une petite partie du Territoire Français, cette élection présidentielle. Je connais la mécanique. Je connais les rouages. Je lui dis clairement que cela ne me fait pas peur. Il n’a pas peur non plus que de confier cela à un jeune administrateur. Je lui en suis gré.
« Mais c’est là où l’on ne mesure pas toujours l’importance du Ministère de l’Intérieur dans notre pays. L’organisation de la démocratie en France est quelque chose d’extrêmement sensible et sur lequel on ne peut pas prendre de risque. Traditionnellement, le Ministère de l’Intérieur c’est une équipe qui est doté de moyens conséquents et sur laquelle l’on nomme des gens très robustes. »
Que retenez-vous de votre passage à l’Assemblée nationale comme conseiller technique du président ?
« Tout d’abord, je rejoins Claude Bartolone en juin 2012, alors même qu’il est élu, un peu, à la surprise générale. Le poste était plus ou moins fléché pour Ségolène Royal, qui est défaite à La Rochelle par Olivier Falorni. Claude Bartolone, qui est un parlementaire expérimenté, se dit : « pourquoi pas moi ?! Je suis populaire au sein du groupe socialiste. » Il connait bien l’Assemblée. Il représente les Banlieues. Il a une forme d’amitié avec François Hollande, même si une forme de distance, parce qu’il était proche de Martine Aubry. Claude Bartolone se lance.
« Quand Claude Bartolone arrive à l’Hôtel de Lassay, il a une équipe politique autour de lui mais il lui manque une équipe un peu technique. Je le rejoins comme conseiller technique pour les affaires constitutionnelles, l’intérieur et l’outre-mer. Ceci pour m’occuper des questions électorales, des questions de sécurité. C’est Yves Colmou qui est venu me chercher et qui a fait l’entremetteur. Il était à l’époque conseiller de Manuel Valls. Il est resté mon mentor, Yves.
« Je débarque à l’Assemblée, autour de Claude Bartolone, avec un positionnement qui est très particulier parce que le travail du président de l’Assemblée c’est beaucoup de présider les séances, organiser les travaux. Cela suppose à la fois de l’autorité et beaucoup de diplomatie.
« Le président de l’Assemblée nationale n’impose rien tout seul. Il a quelques pouvoirs de nomination. Mais pour la gestion matérielle de l’Assemblée dépend des questeurs. L’organisation des travaux, c’est la conférence des présidents. Ce n’est pas un travail solitaire, président de l’Assemblée nationale.
« À ses côtés, les jeunes conseillers que nous étions, l’aidions dans ce travail-là. Avec des contacts permanents avec les parlementaires, avec les Administrations. Claude Bartolone avait aussi souhaité faire de l’Hôtel de Lassay une ruche, avec beaucoup de débats intellectuels, de colloques, de réceptions ou d’intellectuels et de personnalités étrangères.
« C’est une maison qui, je crois, sous Claude Bartolone, a très bien vécue. Claude a été un très bon président de l’Assemblée nationale, très reconnu par l’opposition. Il a su préserver avec hauteur de vue et autorité une forme de crédibilité des débats parlementaires, y compris dans des moments compliqués, je pense à la loi pour le Mariage pour Tous, qui avait été un peu houleux. Si je compare avec la situation d’aujourd’hui, je me dis qu’à l’époque, il y avait peut-être beaucoup plus de retenue, finalement. [Rires] »

Que retenez-vous de votre expérience de conseiller Outre-mer à Matignon auprès de Messieurs Valls et Cazeneuve ?
« Je n’arrive pas à Matignon, aux Outre-mer, par hasard. J’ai travaillé 2 ans dans ce Ministère-là. Pour Claude Bartolone, j’ai beaucoup suivit les dossiers avec les députés ultra-marins. Lorsque Manuel Valls se cherche un conseiller pour ces dossiers-là, mon nom arrive assez spontanément. C’était, là aussi, une expérience passionnante.
« J’ai adoré travailler à Matignon. C’était épuisant ! En vrai, cela reste le lieu où doivent se résoudre les contradictions. À Matignon, on a la contrainte budgétaire. On a la contrainte juridique. On a la pression politique. On a la pression médiatique. Il faut prendre une décision. Je crois qu’il y a peu de lieux dans la République où ne pas décider est déjà décider.
« Un Premier ministre, son travail c’est dans les 5 minutes, de prendre une décision. Le travail de ses collaborateurs c’est à la fois de lui analyser les situations et de lui présenter le champ des possibles. Travailler avec Manuel Valls, puis ensuite Bernard Cazeneuve, était très agréable parce que c’étaient 2 Premiers ministres qui aimaient décider. Ils aimaient trancher, y compris lorsqu’il y avait des choix difficiles à faire. Ils tranchaient. Ils assumaient derrière.
« Le travail d’un conseiller de Premier ministre, ce n’est pas de mettre les problèmes sous la table. C’est de mettre les problèmes sur la table et d’expliquer éventuellement comment on peut trouver un chemin pour les résoudre. En cela, les Outre-mer, c’est souvent un champ de difficulté majeur. Je crois que c’est un ancien ministre des Outre-mer qui m’a dit cela. Il m’a dit : « Dans les Outre-mer, si l’on veut des problèmes, il suffit de se baisser pour ramasser ! »
« Par ailleurs, c’est une fonction très transversale parce que le conseiller Outre-mer il travaille avec le conseiller budgétaire, le conseiller fiscal, le conseiller agricole, le conseiller éducation. J’étais vraiment au milieu de cette fourmilière. J’étais très heureux. Mais je suis sorti de là épuisé, au bout des presque 4 ans de fonction à Matignon. C’était physiquement très dur.
« Ce qui est difficile à gérer, mais cela tous les ministres des Outre-mer le savent, c’est la succession de crises. Manuel Valls le sait mieux que personne maintenant. Vous avez des crises climatiques avec les cyclones et les tempêtes. Vous avez des crises sociales avec des émeutes. Vous avez des crises politiques avec des gouvernements locaux renversés. Il faut tenir tout cela avec parfois une Métropole qui regarde cela avec circonspection. Malgré tout, on ne peut pas ne pas décider sur les Outre-mer. On ne peut pas laisser comme cela, en plan, des Territoires où il y a des problèmes ne serait-ce que sanitaires. »


Quel regard portez-vous sur votre poste de Délégué Interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’anti-LGBT ?
« C’est un poste très particulier, atypique, un ovni dans l’appareil de l’État, mais qui est à la pointe de la défense des valeurs républicaines puisqu’il s’agit de lutter contre la haine de l’autre, la haine de l’altérité. C’est une lutte pour la fraternité, pour la différence, pour l’universalisme des droits et des devoirs.
« C’est un poste qui vous place en contact direct avec le monde associatif. C’est-à-dire avec les associations des droits humains, de lutte contre l’antisémitisme, de lutte contre le racisme, de lutte contre l’homophobie, contre la transphobie, toute la haine anti-LGBT. Dans la même journée, j’étais amené à discuter avec des rabbins orthodoxes comme avec des trans queer. Cela supposait une forme de souplesse.
« J’étais le 2nd, après Gilles Clavreul, qui avait vraiment marqué le job. Il vient d’ailleurs d’être nommé mercredi préfet des Landes en conseil des ministres. Gilles Clavreul avait marqué de son emprunte cette structure qui avait été voulue par Manuel Valls et François Hollande.
« Je prends sa suite pendant presque 4 ans, avec des problèmes majeurs dont on n’est toujours pas sorti aujourd’hui. Ce n’est tout de même pas comme s’il n’y avait pas de problème d’antisémitisme et de racisme en France aujourd’hui.
« Tous ceci avec une politique qui se structure, avec des Ministères qui peu à peu bouge, font des choses. Je pense que l’on a beaucoup fait pendant ces années-là sur l’éducation, la formation, la haine sur Internet. Je suis très fier de l’équipe que j’avais autour de moi. Je suis très fier de ce que l’on a fait à cette époque-là. Je pense que l’on a beaucoup fait mais qu’il reste beaucoup à faire.
« J’ai d’ailleurs déjeuner cette semaine avec l’actuel DILCRAH, qui est un ami. C’était l’ancien chef du Cabinet de Claude Bartolone donc on s’est croisé. On a des parcours entremêlés, lui et moi.
« C’est un très beau combat. Ce combat est difficile parce qu’il faut l’incarner. Il faut faire beaucoup de communication mais en même temps, on ne peut pas faire que de la communication. Ce qui signifie que derrière, il faut qu’il y ait tout un cadre structurel sur l’éducation des jeunes, sur la haine sur les réseaux sociaux etc… Ce n’est pas évident.
« Le fait d’être placé auprès du Premier ministre, avec une délégation interministérielle, c’est bien parce que cela donne de la souplesse. Cela donne de l’autonomie. Mais derrière on n’a pas l’armature d’une Administration centrale comme celle du Ministère de l’Intérieur ou du Ministère des Finances. C’est plus dans l’ambiance commando que Grosse Bertha. »

Quel regard portez-vous sur vos fonctions occupées au sein de la RATP ?
« Après ces presque 4 années à la DILCRAH, c’est la RATP qui est venu me chercher. Il cherchait un haut fonctionnaire avec un double profil. Une personne avec une grande sensibilité sur les questions de discriminations, d’égalité, de diversité et en même temps une capacité à incarner un discours exigeant sur la laïcité et la lutte contre la radicalisation. Mon nom est apparu. J’ai été chassé par un cabinet de recrutement, comme l’on dit. Ce qui est toujours bon, pour l’égo, lorsque l’on vient vous chercher.
« Cela m’intéressait de découvrir le monde de l’entreprise que je ne connaissais pas. Le monde des transports m’intéressait aussi. La RATP c’est une belle entreprise. J’y ai été heureux d’y œuvrer pendant 4 ans. Là aussi, avec des enjeux de droits, de dignités, de cohésions professionnelles. La RATP, c’est 70’000 salariés. On est aussi sur des questions d’harcèlements, d’harcèlements sexuels. Vous en avez régulièrement.
« J’ai été heureux de mettre les mains dans le cambouis pour travailler au sein de cette grande entreprise pour essayer de résoudre le maximum de problèmes. Mais, là aussi, de porter une doctrine, un message clair, ferme, exigeant sur ces questions de laïcité.
« C’était une belle expérience et au bout de 4 ans, le poste s’est retrouvé vacant, ici, aux Régions de France. J’ai candidaté. Carole Delga et Renaud Muselier m’ont fait l’honneur de me désigner comme Délégué général. »
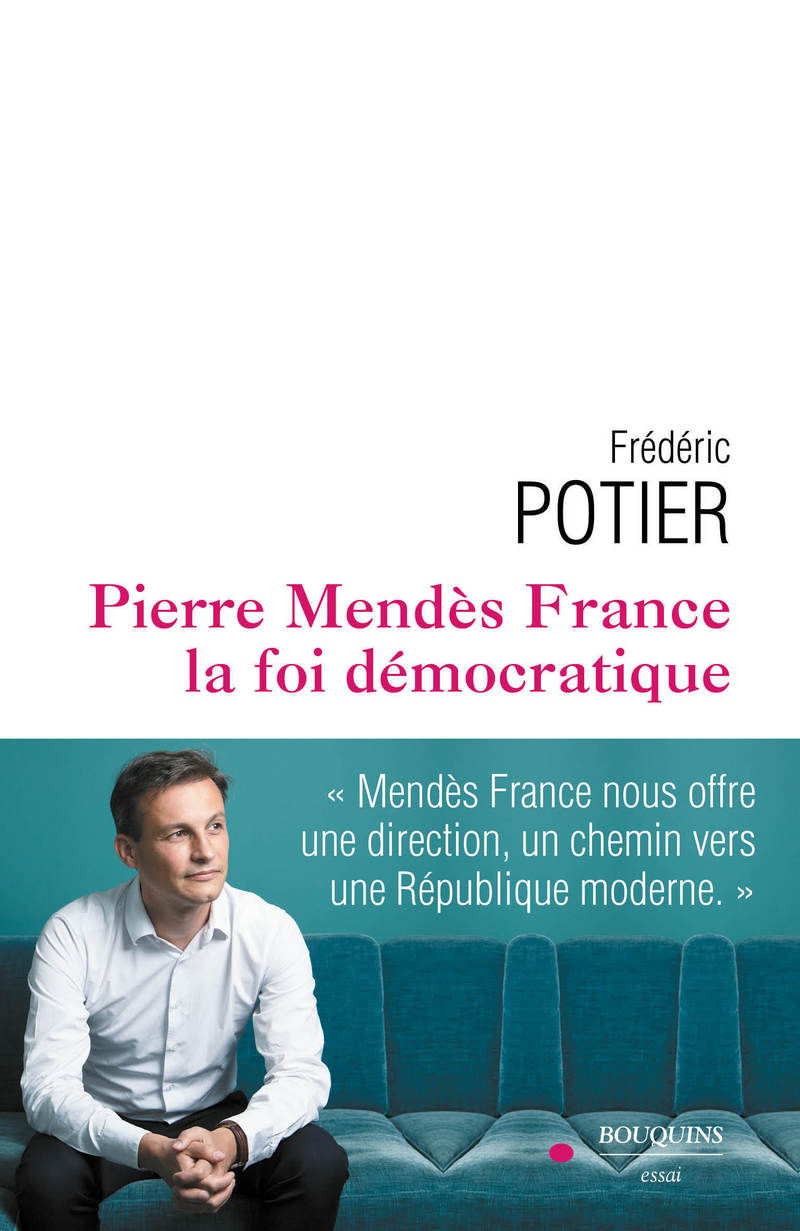
Quel regard portez-vous sur Pierre Mendès France et son héritage culturel et politique ?
« C’est un héritage un peu paradoxal que celui de Pierre Mendès France. Parce qu’à la fois, il n’a été que Chef du Gouvernement que pendant quelques mois (8 mois et 5 jours), et en même temps, la trace est profonde.
« La trace, elle est profonde, parce que Mendès France incarne une forme d’éthique républicaine et des valeurs démocratiques poussés à leurs sommets. Mendès France est l’exemple même que la démocratie n’est pas un vain mot. La démocratie ne se résume pas à des élections. La démocratie c’est un état d’esprit. C’est un « code moral ». Ce qui est une expression importante dans la bouche de Mendès France. Pour ma part, c’est une source d’inspiration majeure. »
« La démocratie, c’est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité : c’est un type de mœurs, de vertu, de scrupule, de sens civique, de respect de l’adversaire ; c’est un code moral »
– Pierre Mendès France.
« Cette exigence-là, de démocratie et de République, Mendès France, il l’a confronté à l’épreuve du pouvoir. C’est très facile de disserter sur les valeurs républicaines. C’est beaucoup plus dur de les concilier avec nos réalités que l’on a à gérer tous les jours. Au fond, le discours de Mendès France qui a une forme de réformisme ambitieux, mais exigeant, je trouve qu’il correspond bien à la période de crise que nous vivons.
« Le livre, je l’ai écrit en 2021. Il y a un réalisme économique évident, lucide. Ceci est mis au service d’une ambition réformatrice. Ce qui, pour moi, est extrêmement important. Le réalisme économique n’est pas synonyme de renoncement, chez Mendès France. Et ce dernier croit profondément au fait que l’action de l’État, l’action républicaine, est le moteur de la transformation du pays.
« Tout son parcours résume cela. Mendès France est jeune Sous-secrétaire d’État au Trésor sous Léon Blum en 1938. Il est 8 mois, Chef du Gouvernement. Il est éphémère ministre d’État sans portefeuille dans le gouvernement Mollet.
« Après, il incarne une forme de figure morale. C’est-à-dire qu’il n’est plus au pouvoir mais il est quelqu’un qui compte. Il est quelqu’un dont la parole est très respectée. Il est au fond quelqu’un qui est un phare qui éclaire dans l’obscurité.
« Je n’ai pas voulu écrire une biographie classique de Mendès France. Il y en a qui sont très bonnes. Il y a celles d’Éric Roussel ou de Jean Lacouture, notamment. J’ai voulu retourner à la source des idées de Mendès France sur l’économie, sur la démocratie, sur la politique étrangère, sur l’Europe, sur la décolonisation. Il a écrit des choses d’une incroyable actualité et d’une très grande pertinence. Mendès France ne s’est trompé sur, à peu près, rien ! [Rires] Il le dit à chaque fois qu’il formule des analyses pertinentes, qui sont d’une incroyable actualité.
« C’est pour cela que le leg de Pierre Mendès France, il est profond. Sachant que sur le bilan gouvernemental, tout de même, il arrive à conclure la paix en Indochine, à octroyer la souveraineté interne à la Tunisie. Il arrive à porter un certain nombre de réformes à un moment où, tout de même, les difficultés sont épouvantables ! Il y a des difficultés économiques, politiques, géostratégiques. Il y a une majorité qui est aussi compliqué que celle d’aujourd’hui.
« C’est une figure qui m’inspire beaucoup, Pierre Mendès France. Je suis heureux que l’on le redécouvre un peu. J’aimerai en revanche qu’on le cite un peu moins mais que l’on le lise un peu plus. »

Comment avez-vous vécu votre rôle au sein la mission sur la Nouvelle-Calédonie, confié par le président de la République ?
« C’est une mission sensible qui nous est demandé d’accomplir au mois de mai 2024, à un moment où la Nouvelle-Calédonie va très mal. On est dans une période d’émeutes, de violences, de crises terribles. Lorsque l’on arrive sur place avec Éric Thiers et Rémi Bastille, je crois que l’on est déjà à 6 morts. On arrive sur place avec le président de la République qui nous demande de mener une mission de rétablissement du dialogue politique.
« On passe presque 3 semaines sur place à prendre le contact, à beaucoup dialoguer avec les élus, avec la société civile. Sans trahir de secret d’État, je pense que l’on peut dire que cette mission a été utile dans le sens où elle a permis de faire comprendre à tout le monde, et je pense que l’on y a modestement contribué, qu’au fond la solution ne pouvait qu’être politique et démocratique. Cette flambée de violence était sans issue pour tout le monde. L’autodestruction de la Nouvelle-Calédonie n’était pas un gage d’avenir. On a fait ce travail-là. Puis d’autres on prit le flambeau.
« Je suis très impressionné par ce qu’a réussi à accomplir Manuel Valls, avec Éric Thiers, qui lui a continué cette mission-là, d’une autre façon.
« Rétablir le dialogue. Rétablir l’ordre public. Rétablir aussi ce qui doit être la nécessité du compromis. C’est comme cela que l’on arrive à sortir d’une période coloniale ou post-coloniale. Je ne sais pas exactement quel est le mot.
« Je pense que l’on n’était pas très nombreux à connaitre la Nouvelle-Calédonie et à pouvoir incarner une forme d’intérêt général et d’impartialité. J’ai été heureux de faire cette mission. Je continue à suivre, évidemment, ce qu’y s’y passe. J’échange régulièrement avec Manuel Valls. J’ai toute confiance dans ses qualités et ses capacités à réussir cet immense défi ! »

Comment vivez-vous votre nouvelle mission en tant que Délégué général de Régions de France ?
« C’est un très beau poste !
« D’abord, je travaille avec des présidents de Régions qui sont extrêmement compétents. Ils connaissent très bien leurs politiques publiques. Ils ont de la hauteur de vues. Ils sont reconnus. Par ailleurs, qui ont accepté, dans cette association, de travailler de manière transpartisane, pour défendre le fait régional et la capacité à transformer le réel à partir des Territoires.
« À Régions de France, j’ai une petite équipe d’une vingtaine de personnes, avec des conseillers techniques spécialisés dans leurs thématiques (transport, finance, éducation etc…). Mon travail ici, c’est de suivre évidemment toute l’actualité gouvernementale et parlementaire. C’est de tenir informé les Régions, et en particulier leurs présidents. C’est d’essayer, tant que possible, de bâtir des positions collectives. On y arrive très largement sur pleins de sujets.
« En même temps, rappeler que les désaccords entre présidents de Régions sont aussi quelques choses de logique à partir du moment où les Régions sont des espaces démocratiques. Les Régions sont des espaces démocratiques. Les régions sont des espaces politiques et ne sont pas des opérateurs de l’État. Les Régions ne sont pas des opérateurs administratifs.
« Donc, les présidents de Régions ont des visions pour leurs Territoires, ont des visions pour leurs Régions. C’est tout à fait logique, normal, que sur un certain nombre de sujets ils puissent y avoir des divergences ou des nuances.
« La vision économique de Valérie Pécresse n’est pas exactement la même que celle d’Alain Rousset. Ce qu’il se passe en Bretagne, ce n’est pas exactement la même chose que ce qu’il peut se passer dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cela aussi il faut savoir l’expliquer, le banaliser. Tout ceci sur un certain nombre de politiques.
« S’il on prend l’actualité récente, sur la culture, l’économie sociale et solidaire, les transports, la fiscalité, il y a des nuances fortes entre les présidents de Régions. C’est la preuve que ce sont des espaces de vies démocratiques. »

Vous publiez aujourd’hui une postface de Lettre à l’éléphant de Romain Gary. Comment est né votre rencontre avec Romain Gary ?
« [Rires] Ce brave Romain Gary.
« Je lis Romain Gary depuis mon plus jeune âge puisqu’un jour mon papa, qui n’avait pas connu son père, m’a offert La promesse de l’aube, où Romain Gary parle de sa mère. Je trouve que c’est un ouvrage très touchant, très drôle. Il y a évidemment une grande part de romanesque dans ce livre. Tout n’est pas vrai, forcément.
« La vie de Gary est un roman incroyable ! En même temps, c’est un authentique héros, résistant, aviateur. Il a été un authentique diplomate. Il a été un authentique écrivain. Une vie incroyable ! Une immense liberté que celle de Romain Gary. Je ne vais pas dire que j’ai essayé de suivre son modèle, parce que cela n’est pas vrai, mais j’ai toujours admiré cela.
« C’est cette forme ce liberté absolue. C’est cette forme de distance aussi. Romain Gary se défiait absolument des idéologies, des modes, des formules, du prêt-à-penser. Je me retrouve beaucoup là-dedans. Je regarde les actes. Je regarde les discours et les actes.
« Le début de La promesse de l’aube est magnifique. La fin aussi. C’est un livre que je relis souvent. Il y a une phrase, que je ne pourrai pas citer parce que je n’ai pas une très bonne mémoire, mais je crois qu’il dédit l’ouvrage « à sa mère et à ceux qui habitent la Terre de leurs amours et de leurs courages ». Il faudra la retrouver mais c’est une très belle citation. »
« J’ai grandi dans l’attente du jour où je pourrais tendre enfin une main vers le voile qui obscurcissait l’univers et découvrir soudain un visage de sagesse et de pitié ; J’ai voulu disputer, aux dieux absurdes et ivres de leur puissance, la possession du monde, et rendre la terre à ceux qui l’habitent de leur courage et de leur amour. »
– Romain Gary in La promesse de l’aube, édition Gallimard – 1960.
« Je lis Gary depuis longtemps. J’aime beaucoup son humour. Je pense que notre époque manque terriblement d’humour. C’est fondamental ! Je trouve que l’humour c’est une preuve magnifique d’intelligence. Les personnes qui n’ont pas d’humour, je m’en méfie un petit peu. [Rires] Par ailleurs, cela fait partie du kit de survie humaniste. Je ne sais pas comment l’on peut vivre sans humour ?! Je ne crois pas que cela soit possible, d’ailleurs.
« Lorsque l’on m’a proposé d’écrire la postface à cette Lettre à l’éléphant, je dois avouer que je ne connaissais pas le texte. Je ne l’avais pas lu. Je connaissais bien la Lettre aux Juifs de France. Mais je n’avais pas souvenir de cette Lettre. Lorsque les éditions de l’Éclaireur m’ont proposé d’en écrire la postface, j’en ai été très heureux, très honoré.
« J’ai d’ailleurs largement écrit cette postface à Nouméa entre 2 réunions politiques et/ou 2 réunions de crises. Il est vrai que relire Romain Gary et écrire sur Romain Gary, cela m’a donné un bol d’air qui était très salutaire, à l’époque. »
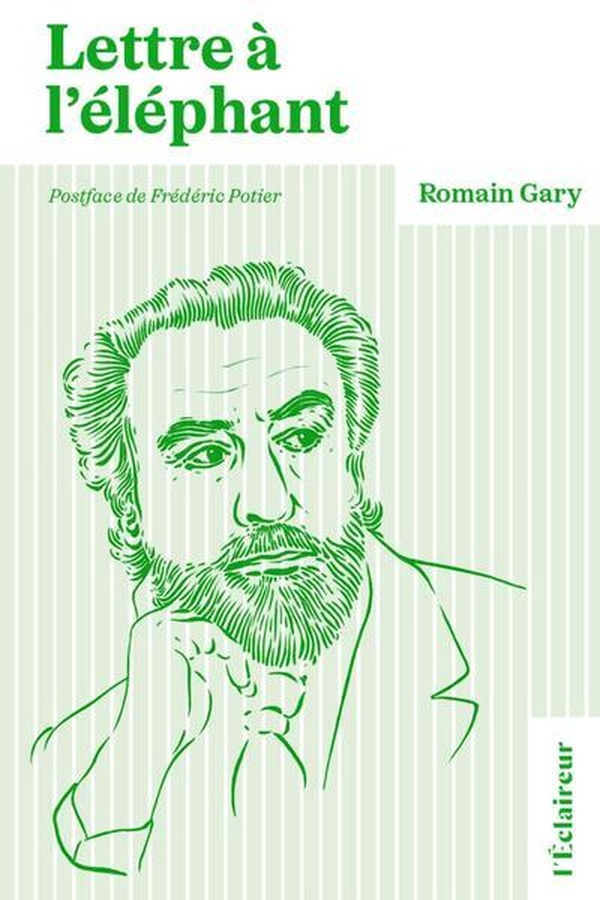
Quel rapport avez-vous avec les réseaux sociaux ?
« … Mes rapports avec les réseaux sociaux… Je dirais que j’ai un rapport utilitaire. Je reconnais leurs efficacités. Je reconnais leurs nécessités pour communiquer aujourd’hui. Cela fait partie de la vie politique. Cela fait partie de la vie intellectuelle.
« Après, je n’ai pas de fascination particulière pour ces outils-là. Par exemple, j’ai quitté X, parce que je trouvais qu’il y avait une agressivité permanente. Le moindre commentaire suscitait une avalanche d’insultes. Y compris des messages assez anodins. Comme par exemple, Jérôme Guedj, un ami député socialiste, qui signale la parution de mon ouvrage sur Mendès France. Tout de suite, un flot gratuit d’insultes qui fusent, pleins de choses horribles ! Quelque chose d’anodin. Aucun regret d’avoir quitté ce réseau social.
« J’aime bien LinkedIn. Je trouve que c’est un réseau social qui est différent. On communique sur ce que l’on fait et l’on n’est moins dans la réaction de ce qu’un tel dit ou un autre fait. C’est très professionnel. Je m’y sens un peu plus à l’aise.
« J’aime bien Instagram pour son côté un petit peu Bisounours avec les photos de paysages, de personnes et de plats.
« Cela fait partie de la vie mais après je me préserve beaucoup de temps de lecture, d’écriture.
« Par exemple, je suis très heureux et très fier d’écrire tous 15 jours dans La République des Pyrénées. Savoir que plus de 20’000 personnes vont ouvrir le journal le samedi matin, dont mon papa et ma maman, et qu’ils vont tomber sur une chronique de Frédéric Potier. J’en suis à la fois très heureux et en même temps, cela me met une petite pression parce que lorsque cela ne leur plait, ils n’hésitent pas à me le dire. [Rires] Il y a le courrier des lecteurs. Sauf que le courrier des lecteurs, dans ce cas-là, il passe par SMS. [Rires]
« Je suis vraiment attaché à l’écrit et aux textes. J’ai le bonheur d’avoir des enfants qui lisent beaucoup. Ils ont tout le temps un livre dans les mains. C’est un grand bonheur. Le jour où l’on ne lira plus, j’en serai le premier navré et le premier extrêmement inquiet. »
***
Merci à M. Potier pour son écoute et sa participation à cet entretien-portrait.
Merci à M. Gonin pour son aide précieuse.